| |
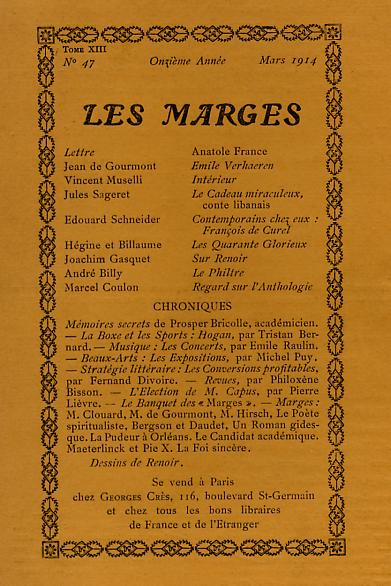
C'est en contemplant les œuvres des grands peintres flamands, les Rubens et les Jordaens, qu'Emile Verhaeren eut la première intuition de ce que devait être son art : la vie apparut au jeune poète comme une fête perpétuelle des sens, une joie luxuriante et saine. Mais pour se hausser à cette conception païenne de l'art, il lui fallait d'abord renverser les valeurs sentimentales du romantisme, et son œuvre, des Flamandes à la Multiple Splendeur sera, en effet, comme une tentative de s'évader de la religiosité maladive du dix-neuvième siècle finissant, pour retrouver, dans toute sa pureté, le paganisme de sa race.
Je ne sais de quels éléments ethniques se compose la race flamande, quelle dose de sang germain et de rêve scandinave s'y mêlent à l'ardeur espagnole ; mais je pense que cette race flamande n'a sans doute pu fleurir artistiquement qu'au tiède contact de l'Espagne. C'est cette influence étrangère qui a produit les grands peintres de ce pays, en créant, chez les Flamands touchés par la caresse espagnole, cet élément d'inquiétude atavique, sans lequel il n'est point d'art. L'art est l'expression d'une inquiétude, d'un besoin de reconstituer en soi une atmosphère vitale, et c'est sans doute cette nostalgie inconsciente du soleil qui a fait éclore, sous le ciel brumeux des Flandres, cette floraison merveilleuse de coloristes. Cette théorie pourrait s'adapter à tous les peintres, et, en général, à tous les artistes, poètes et musiciens, ainsi que j'ai déjà tenté de le démontrer, en un essai de physiologie poétique.
Il y a ainsi, chez l'homme, une constance de la sensibilité, et les chimistes pourront un jour analyser les diverses réactions artistiques : le degré de la couleur chez le peintre, de la vibration chez le musicien, de l'émotion chez le poète ; ces artistes, élevant ou abaissant instinctivement leur température émotionnelle, afin d'atteindre leur constance pour ainsi dire ethnique.
Mais en même temps que l'artiste s'équilibre par le jeu des sons, des couleurs et des rythmes, il crée de nouvelles gammes sentimentales et émotionnelles qui permettent aux êtres d'une sensibilité identique de s'harmoniser eux-mêmes à son rythme.
Ce n'est pas par simple curiosité intellectuelle que Verhaeren a été littérairement attiré vers l'Espagne de Philippe II. Mais c'est moins dans cette manifestation trop directe qu'on découvre cette hantise espagnole, que dans cette recherche obstinée de la lumière qui caractérise la poésie de Verhaeren. Il y a dans ses vers le geste perpétuel d'écarter des branches et des nuages, et le poète n'atteint sa pleine respiration poétique que dans la clarté. Les belles heures de sa vie sont les heures claires.
On a dit que ce qui faisait la qualité de la poésie Verhaerienne, c'était qu'elle s'adaptait à sa race et à son siècle, et M. Buisseret nous a révèle l'effort douloureux de cette adaptation. Pour entrer résolument dans la vie, comme en un fleuve, Verhaeren a dû se dépouiller des vêtures mystiques et morales que ses hérédités germaniques avaient collées à sa chair Il a dû lui aussi, homme du Nord, hanté par les fantômes d'Hamlet, se créer un soleil et une atmosphère légère, claire, voluptueuse, et marcher dans ce rayonnement jailli de son cerveau, vers la Multiple Splendeur.
Qu'il sera d'abord douloureux, halluciné, ce chemin du poète mystique vers la porte de vie ; chacun de ses volumes marquera une des stations de ce calvaire. Mais, arrivé au sommet de la colline, comme il respirera, et, prophète d'une vérité toujours méconnue, chantera la beauté de la vie !
C'est, écrit M. Georges Buisseret, en son petit essai sur Verhaeren, « une victoire assez semblable qu'avait rêvée Nietzsche qui voulait lui aussi et à tout prix la joie, et chez qui l'on retrouve des souffrances et des révoltes identiques à celles d'un Verhaeren. Ces deux génies livrèrent le même combat ardent et sans merci, et ce n'est peut-être que la mauvaise humeur sarcastique de Zarathoustra, absente chez l'auteur des Visages et des Forces qui différencie tant leurs accents respectifs. Mais si Nietzsche lutta jusqu'à en perdre la raison et sans parvenir tout à fait à se dégager du marécage et à se débourber, notre poète, lui, en sort vainqueur. Cet état de sérénité où Nietzsche aspirait et qu'il n'atteignit pas, qu'il ne pouvait pas atteindre, il semble à peu près certain aujourd'hui que Verhaeren y soit parvenu dans cette Multiple Splendeur libératrice. »
Libéré de son angoisse métaphysique, Verhaeren a voulu tout aimer, tout comprendre, tout admirer, et cet effort d'amour, de compréhension et d'assimilation aura fait de lui le poète de son siècle. On ne sait par quel miracle, le Destin avait réservé cette sensibilité vierge pour être le miroir de notre civilisation. Le levain de son inspiration fut, en effet, l'étonnement devant la vie. Elevé à l'abri de toute civilisation, au creux d'un petit village flamand, et placé tout d'un coup, à un âge où la sensibilité est toute neuve, devant le spectacle de la Ville, Verhaeren a vu ce que nous, plongés dans le gouffre même, nous n'avions jamais regardé. Et vraiment il fallait, pour transformer ainsi, en un monstre apocalyptique et tentaculaire, la ville qui nous est si chère et si familière, et en créer une vision dantesque, il fallait un regard innocent, un regard vierge d'enfant étonné. La poésie de Verhaeren est souvent cela : l'étonnement d'un enfant devant la vie qu'il découvre avec des yeux nouveaux.
Le poète éprouvera la même surprise devant la science et la philosophie : il boira avec avidité à ces sources nouvellement jaillies des sciences modernes et y puisera encore une foi. Il ne cherchera plus l'espoir au delà des cieux, mais il se créera humainement une nouvelle et tout de même consolante illusion : la certitude d'une évolution terrestre vers la bonté par plus de raison et plus de science. A cette évolution morale, il participe par son art, qui est devenu pour lui la foi merveilleuse, sa religion, sa contrainte, son cilice voluptueux. Il dit aux Moines qui vivent, les yeux rivés sur leur christ d'ivoire :
Tel que vous devant lui, l'âme en flamme, à genoux,
Le front pâli du rêve où mon esprit s'obstine,
Je vivrai seul aussi, tout seul, avec mon art,
Et le serrant en main, ainsi qu'un étendard,
Je me l'imprimerai si fort sur la poitrine,
Qu'au travers de ma chair, il marquera mon cœur.
Car il ne reste rien que l'art sur cette terre
Pour tenter un cerveau puissant et solitaire
Et le griser de rouge et tonique liqueur...
Pour lui l'art est un sacerdoce intime pour la culture de la perfection humaine. Je ne sais pas, en effet, d'art plus sain et moins équivoque que celui du poète des Forces tumultueuses. Le sensualisme de cette poésie est d'une telle franchise de nudité et de rut qu'elle est sans surprise et ne nous donne qu'une émotion visuelle... celle même que nous éprouvons devant telle toile de Rubens :
Un combat chair à chair de gouge avec son mâle,
Des étreintes de corps à se briser les reins,
Des vautrements si fous que l'herbe en est broyée,
Comme après un assaut de vents et de grêlons
Des buissons cassés net et la terre rayée
D'un grattage lascif de pieds et de talons.
Nous sommes loin du subtil pays des Fêtes galantes et des Amies, des tendresses craintives et des âmes qui s'étonnent et qui tremblent... Mais cette santé morale, un peu barbare, on la retrouvera jusque dans la délicatesse du lyrisme intime des Heures claires et des Heures d'après-midi. Aucune poésie ne m'a donné une si parfaite sensation de calme ému et une sérénité si lucide et si limpide. Nous sommes dans le Paradis terrestre, et vraiment le poète a retrouvé dans l'amour l'état parfait de bonheur et d'innocence :
|
Je sens en toi les mêmes choses très profondes
|
|
|
|
Et notre soif de souvenir
|
|
Boire l'écho où nos passés se correspondent.
|
|
Nos yeux ont dû pleurer aux mêmes heures
|
|
Sans le savoir, pendant l'enfance ;
|
|
Avoir mêmes effrois, mêmes bonheurs,
|
|
Mêmes éclairs de confiance ;
|
|
Car je te suis lié par l'inconnu
|
|
Qui me fixait jadis, au fond des avenues
|
|
Par où passait ma vie aventurière ;
|
|
Et certes si j'avais regardé mieux,
|
|
J'aurais pu voir s'ouvrir tes yeux
|
|
Depuis longtemps en ses paupières.
|
C'est l'amour dans toute sa merveilleuse candeur, le rêve éternel et toujours réalisé, à chaque minute sur la terre, de l'identification de deux êtres qui s'aiment et se confondent. Verhaeren ne s'analyse ni devant ses sentiments, ni devant ses sensations : il les voit devant lui comme un peintre voit un paysage. Et il y a chez lui, non pas l'inquiétude du poète, mais la sérénité, toujours étonnante, du peintre. Dans sa joie, comme dans sa douleur, Verhaeren est toujours grave ; il ne connaît pas l'ironie. Ce qui domine son âme, c'est le besoin d'une foi. Lorsqu'il dut jeter par dessus sa nacelle ses anciennes croyances, il faillit se perdre dans la démence, et il ne retrouva son aplomb qu'en se lestant d'une nouvelle suggestion : l'amour de la vie. Il avait compris que l'homme et que le poète, qui est une exagération de l'homme, ne devait prendre son point d'appui qu'en lui-même. C'est le parfait équilibre physique et mental, et lorsqu'un poète a atteint ce synchronisme de ses facultés, il devient une sorte de dieu qui reflète la joie et la beauté de l'univers. Il a atteint une sorte de nirvana.
Je n'ai pas tenté d'analyser ici l'œuvre d'Emile Verhaeren qui a été étudiée tant de fois déjà et quelquefois avec minutie. J’ai seulement essayé d’en découvrir les raisons secrètes. MM. Bazalgette, Maurice Gauchez, George Sautreau, Georges Buisseret nous ont dit la vie du poète, le sens de sa poésie et son « évolution idéologique ». M. Stefan Zweig, medium de la pensée allemande, voit en Verhaeren le plus grand poète français. Non, Verhaeren est un grand poète, mais il échappe à notre tradition française et à notre culture classique. C’est ce qui fait son originalité, sa personnalité. Il ne faut chercher dans son œuvre ni l'eurythmie de Moréas ni l'aristocratisme de Régnier, car Verhaeren ne perpétue pas une tradition ; il en inaugure une nouvelle.
Et quant à sa langue, elle n'est ni classique, ni romantique, ni symboliste : elle est flamande. A ce sujet M. Maurice Gauchez écrit : « Verhaeren a des adverbes substantifs : les ailleurs, les n'importe-où, mon navire d'à travers-tout, les loins, les naguères, un tout-à-coup de fou désir, un tout-à-coup de gel. Il en a qui sont adjectifs : mon toujours esseulement, l'à-travers-tout galop des comètes, la souvent maison de ma douleur... etc. » Et, plein d'admiration pour ces singuliers assemblages d'adverbes et de substantifs, M. Gauchez voudrait nous faire croire que « Verhaeren a introduit, infusé dans le verbe français les harmonies germaniques, les onomatopées, les résonnances insoupçonnées, les ressources de force et de vibrance... etc. » Ah non ! ces germanismes sont et demeureront inassimilables à la langue française : ce n'est là que du flamand traduit en français.
Comme il a sa langue personnelle, Verhaeren s'est aussi créé son vers, le vers libre verhaérenien, qu'il manie avec une souplesse pleine de fougue. On a beaucoup écrit sur le vers libre, mais le vers libre en soi n'existe pas, puisque par définition même il échappe à toute règle. Nous ne connaissons guère à cette heure que le vers libre de Verhaeren et celui de Vielé-Griffin. Alors on se demande si le vers libre ne serait pas incompatible avec le génie français, s'il ne serait pas seulement une curieuse, mais vaine, tentative d'adaptation au vers français de la métrique allemande et anglaise.
En tout cas le vers libre français, d'un maniement si délicat, semble de plus en plus abandonné par les poètes nouveaux qui reviennent aux rythmes anciens, et éternels, puisqu'ils sont la mesure et la cadence même de notre respiration organique. Et le vers libre quelque compliqué qu'il soit, pour être senti musicalement, doit rentrer dans cette cadence, avec ses silences et ses points d'orgue. Nous sommes, en France, si amoureux de mesure et de discipline qu'on attendait, semble-t-il, que le vers libre ait fixé ses règles, c'est à dire ait cessé d'être libre, pour le faire entrer dans notre art poétique. Certes, instinctivement le poète de génie gradue la mesure de son rythme selon l'intensité et la nuance de son émotion, et c'est même cette sûreté d'adaptation du rythme à l'émotion qui caractérise le vers de Verhaeren : emporté par la vague tumultueuse de sa pensée, le poète ne crée pas l'élan et la musique de son vers, il les subit, comme la mer subit le choc des rochers sur lesquels elle est précipitée et qui lui imposent la courbe de ses volutes et le diapason de sa sonorité.
C'est donc en vain que des esthéticiens de bonne volonté tenteraient de nous donner la méthode d'orchestration et le leit-motif individuel de cette musique wagnérienne, afin d'inciter les jeunes poètes à l'imiter. Cette musique est inimitable et inassimilable, car elle est l'expression d'un tempérament, d'un organisme et d'une individualité indépendante de toute culture et de toute tradition française. Et peut-être que de le savoir ainsi isolé dans son génie flamand, Verhaeren qui a utilisé pour son œuvre fastueuse et tumultueuse les souplesses et les richesses de notre langue, nous en paraîtra plus grand.
Mais il faut faire resurgir ici, en terminant cet essai, l'idée d'inquiétude atavique formulée aux premières lignes. Que les ethnographes de la psycho-physiologie recherchent les éléments raciques du poète des Flandres, et nous disent quelle dose de mysticisme espagnol se mêle dans son œuvre au songe germain et au rêve Scandinave.
JEAN DE GOURMONT.
pp. 155-163.
Un jeune critique, M. Clouard, dont on apprécie la persévérance avec laquelle il essaie de définir et de classer ses goûts — encore qu'à notre sens mieux vaudrait sans doute, à la place de tous ses distinguos, qu'il eût tout bonnement et simplement du goût — se demande « pour quel affranchissement de la littérature contemporaine Les Marges partent en guerre... » II n'aperçoit pas du tout l'étouffement dont nous avons parlé. Il paraît que l'air du jour est excellent pour ses poumons.
C'est, ma foi, dommage.
Ce M. Clouard ne sourit jamais ; il a tout à fait l'air de croire que c'est arrivé ; il se prend incroyablement au sérieux. A peine si nous allons oser lui dire qu'il a bien tort. Il ne sourit jamais. Pouvons-nous lui chuchoter à l'oreille qu'il nous fait quelquefois sourire, nous quand il ne nous fait pas — mais hélas ! comment lui dire cela ! — quand il ne nous fait pas... — allons tant pis ! — quand il ne nous fait pas bâiller...
Mais oui, vous nous faites souvent bâiller, M. Clouard !
M. Rémy de Gourmont voit bien, lui, de quoi il s'agit :
« La liberté. Seigneur, où allons-nous ? écrit-il. La liberté, quand la sainte tradition nous enseigne au contraire la soumission aux bonnes règles et aux bons principes ! La liberté de l'art mais c'est l'anarchie ! Quant à la liberté de la pensée, c'est bien homaisien !... Mais non ! Ne confondons pas la liberté de la pensée qui est sereine, relève la tête et regarde la vie avec ses yeux clairs, et l'agressive libre-pensée. La libre-pensée est un parti politique, et la liberté de la pensée est l'état d'esprit des hommes intelligents. Il n'est pas, à proprement parler, d'hommes dignes de ce nom sans la liberté de la pensée qui permet la liberté du jugement et le développement de la sensibilité personnelle. La tradition française est une suite d'indépendances et d'originalités depuis Montaigne jusqu'à Renan. En termes plus nets, M. Eugène Montfort trouve que depuis quinze ans (car cette autre tradition remonte à peine aussi haut) les lettres françaises ont un peu trop oublié leurs vraies origines et un peu trop piétiné le véritable esprit français. Les Marges les rappelleront au sentiment de leur dignité et de leur plénitude. »
|