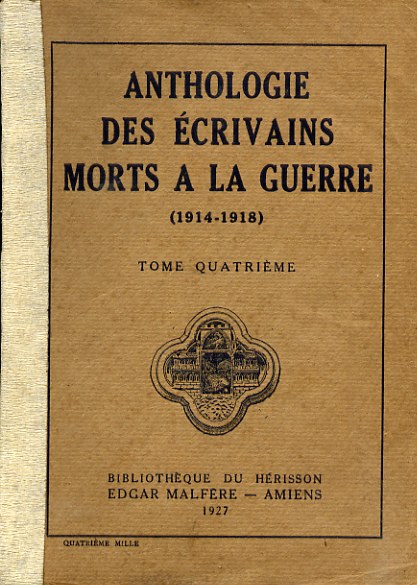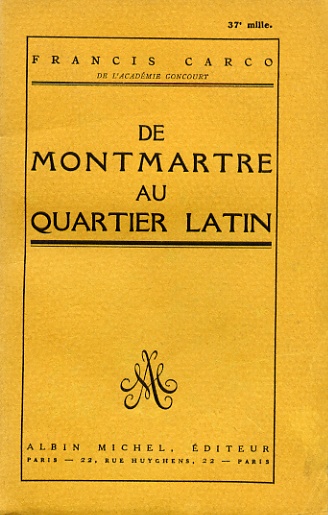|
André du Fresnois (1887-1914) |
||
|
ANDRÉ DU FRESNOIS 1887-1914 André du Fresnois était son pseudonyme. Son nom : André Cassinelli. Il naquit le 1er avril 1887, à Vanves, où son père était économe du lycée Michelet. Au hasard des déplacements paternels, il fit ses études aux lycées de Saint-Quentin, de Troyes, puis de Nancy, où il eut, en rhétorique, le même professeur que Maurice Barrès, quelque vingt ans plus tôt. Quelle rencontre émouvante pour un jeune garçon qui rêvait déjà de gloire littéraire, que celle du grand écrivain dont la griffe juvénile se voyait encore à la première page de tels livres de classe... Mais Barrès était déjà familier à ce lycéen de quinze ans qui lisait le Culte du moi en cachette pendant les cours d'allemand ou de mathématique, au risque d'ignorer toujours la langue de Gœthe et les éléments de la géométrie plane. Enfant silencieux et sensible, il se gorgeait de lectures dont il faisait autant d'émotion, et l'histoire de sa jeunesse tiendrait toute dans celle de ses découvertes littéraires... On le vit, environ sa vingtième année à Paris, où son père venait d'être nommé économe au lycée Carnot. Après sa licence et son service militaire, André du Fresnois devint secrétaire d'un sénateur radical, fit des besognes de journalisme, écrivit dans ces petites revues qu'il fondait avec deux ou trois camarades ; mais sous les hasards capricieux de sa carrière et quels qu'en dussent être parfois les assujettissements, une personnalité se dégage, pleine d'une grâce indépendante et fière, qui savait tout ensemble conquérir et le cœur et l'esprit. Ce grand jeune homme, élancé et souple, d'une élégance naturelle et un peu nonchalante — malgré l'ardeur et la vivacité qu'il portait dans les choses de l'esprit, — je l'ai rencontré, par hasard, vers 1908, chez Jean Royère, à La Phalange. Dans ce milieu du symbolisme attardé, où passaient de bien étranges personnages, survivants d'une secte bizarre, du Fresnois semblait prodigieusement se divertir... Il était clair qu'il était d'une autre génération, et rien qu'à le voir on pouvait déjà pressentir qu'il y avait quelque chose de changé dans la conception qu'un jeune écrivain se faisait de la vie littéraire... Jeunesse impitoyable ! J'entends encore nos éclats de rire quand nous eûmes quitté cette étonnante compagnie. Mais qu'une telle scène, à distance, m'apparaît significative !.. Ce rire de du Fresnois, c'est la réaction de tous ces garçons qui eurent vingt ans aux environs de 1905 et qui, dès leur début dans la vie intellectuelle, se montrèrent mieux armés que leurs aînés pour échapper aux .sollicitations de la barbarie... Grâce à eux, beaucoup de nuées ont été dissipées ; beaucoup d'idoles auxquelles leur étrangeté, leur « mystère », composait une sorte d'auréole, ont été renversées, ou bien, pressées de toutes parts, ont dû confesser leur imposture. « Nous avons assisté, dira du Fresnois qui fut l'un des artisans de cette renaissance, nous ayons assisté à un heureux renversement des termes, et le ridicule s'attache aujourd'hui aux opinions dépravées ; c'est l'anormal que nous estimons banal. Il faut se rappeler l'état d'esprit de la génération symboliste pour apprécier celle qui se plaît aux comédies de Lemaître, aux romans de Boylesve, aux études de Maurras. » De celle-là, André du Fresnois fut un des plus authentiques témoins ; et ce sont les propres traits de sa figure morale qu'il dessinait dans la réponse qu'il fit vers 1912 à notre enquête sur les Jeunes gens d'aujourd'hui : « Je sens chez tous, écrivait-il alors, quelque chose de naturel, de sain, d'honnête, qui fait plaisir... Je sens qu'ils ne sont pas systématiquement détachés de tout ce qui constitue des raisons de vivre pour cette immense partie du genre humain qui n'a pas l'honneur de « faire de la littérature » ; qu'ils ne considèrent pas leurs semblables, paysans ou soldats, professeurs ou commerçants, comme un bétail inférieur, susceptible seulement de fournir des « sujets » à l'artiste ; et qu'en un mot si l'histoire de des Esseintes leur était contée, ils y trouveraient un plaisir extrême, mais aux dépens et du héros et de l'auteur qui a pu prendre ce héros au sérieux et presque au tragique. » Et il ajoutait : « Une autre forme de la perversité, dont il paraît bien que nos jeunes écrivains soient exempts, c'est la croyance à l'éminente dignité de la douleur, de la douleur en soi, parce que l'homme qui souffre est essentiellement individualiste, anti-social et anarchiste. De là notre défiance en face de l'esthétisme d'un Porto-Riche, notre agacement en présence des personnages neurasthéniques de M. Bataille, notre parfait mépris de la barbarie qui éclate dans le théâtre de M. Bernstein. Les héros de Porto-Riche et de Bataille nous tiennent pour des types inférieurs d'humanité, nous tous qui faisons quelque cas du bon sens, de l'équilibre, de la santé ; ils considèrent, dans le secret de leur pensée, la fin de leurs souffrances comme une diminution d'eux-mêmes, et comme une déchéance. Et l'auteur ne laisse pas entendre que tous ces Orestes sont fous. Voilà une attitude tout à fait étrangère aux écrivains français de la bonne époque. » Est-ce à dire que du Fresnois fût un moraliste ? Disons plutôt que, chez lui, sûreté de goût, sûreté du sens moral, étaient une seule et même chose. Nul n'avait moins de certitude métaphysique ou religieuse ; il se montrait même quelque peu sceptique en ces matières ; toujours est-il qu'il lui répugnait d'avoir l'air de prêcher, et quand il écrivait : « Nous n'avons plus le goût du vice », ce n'était pas qu'il prétendît plaider pour la vertu, ou bien il faut entendre ce mot selon le seul sens latin. Mais il avait horreur de l'attitude, de toute affectation ; comme d'un ridicule, sans doute ; bien plus, comme d'une déchéance où se révèle quelque dépravation de l'esprit et du cœur. Et c'est avec la spontanéité, l'infaillibilité et la force d'un instinct qu'il décelait le faux dans les idées et dans les sentiments. Art de vivre, art tout court ne faisaient qu'un pour lui. Il ne les séparait jamais. Cette intime liaison, toute sa critique la manifeste. « Il est normal, disait-il, que l'anormal existe, mais désastreux qu'il s'étale au premier plan. » Et la pire immoralité lui semblait être de ne pas appeler les choses par leur nom, de montrer la révolte et de l'appeler la beauté ; de montrer l'adultère, et de l'appeler un droit ; de montrer le désordre et de l'appeler la règle ; bref de renverser ces hiérarchies établies dans toute âme bien faite — ce qui est le propre de la corruption romantique. Dans le classicisme, André du Fresnois avait trouvé tout ensemble une esthétique et une règle de vie. Les classiques lui montraient l'homme, en ce qu'il a de commun avec tous les hommes, et c'est en cela qu'ils sont d'admirables éducateurs. Sauver ce patrimoine, protéger le dépôt dont nous avons la garde, ne pas laisser pervertir cette sensibilité policée par cinq ou six siècles de culture, telle lui semblait être l'œuvre dévolue à notre génération. « Si la joie de créer nous est refusée, disait-il, ne laissons pas échapper celle de comprendre. » Et tout d'abord il entendait être de ceux qui travailleraient à maintenir, à réformer le goût, à refaire un esprit public. « C'est ce public, écrit-il, dont l'existence fit de la France. dans le passé, une nation à part, au-dessus des autres nations, et digne de leur imposer sa conception de la vie. C'est à ce public que s'adressaient les écrivains classiques, c'est grâce à lui qu'ils avaient le sentiment de se trouver en communion avec d'autres hommes, sentiments si nécessaires à l'artiste soucieux de contenir dans les limites de la raison une humeur parfois aventureuse. » De telles tendances devaient rapprocher André du Fresnois des jeunes disciples de Maurras qui venaient de fonder la Revue critique des Idées et des Livres. C'était là qu'était sa vraie famille spirituelle ; c'est là, mieux encore que dans ses chroniques du Gil Blas, de l'Opinion, des nombreux journaux où il dépensa un merveilleux talent, qu'il faut aller chercher sa pensée authentique. Non pas qu'il fût capable de la dénaturer ou de lui faire subir une altération, si légère fût-elle ; mais il n'était tout à fait à son aise que là où il pouvait tout dire. Car si sa doctrine était accueillante et large, il avait une doctrine. Qu'on lise sa préface aux Pages choisies de Jules Lemaitre qu'il publia en 1911 à la Nouvelle Librairie Nationale ; on l'y trouve tout entier avec cette maîtrise de critique qui étonne chez un garçon .de vingt-quatre ans. Les formes et les tendances les plus diverses pouvaient bien solliciter son esprit, il ne renonçait pas à les définir, à les juger. « Bon gré, mal gré, disait-il, chacune de nos paroles constitue un jugement. Il nous est loisible, après cela, de nous réclamer de la sensibilité contrôlée, du goût, de l'expérience, plutôt que des principes absolus ; qui ne s'apercevra que c'est tout uniment la même chose avec moins d'embarras? » Par ces principes, André du Fresnois se rattachait à ces écrivains patriotes qu'on appelle communément « réactionnaires ». Mais, à ses yeux, être réactionnaire, ce n'était pas tant affaire de politique que de conduite, d'idées et de goût. Quant au patriotisme, il aurait rougi qu'on lui fît un mérite d'un sentiment si naturel. C'était, pour lui, « un signe bien attristant du désordre des esprits que de les voir sans cesse reprendre l'examen des vérités les plus simples, et dont l'acceptation tacite est nécessaire à la dignité comme à l'agrément des relations humaines. » A de tels traits, on peut juger de la pudeur, de la délicatesse de cet esprit si juste et de ce cœur si droit. Son amitié même avait je ne sais quelle discrète réserve : il pensait que c'était là matière délicate où l'on s'entend à demi-mot et sur quoi l'on ne saurait insister sans offenser gravement la pudeur sentimentale. Cette discrétion enveloppa toute sa vie et jusqu'à sa mort : c'est miracle qu'il ait pris soin de recueillir en un volume quelques-uns de ses articles de critique littéraire — tout ce qui nous reste de lui. Le jour de la mobilisation, j'allai lui dire adieu dans ce bureau de journal où il venait de remettre, ainsi qu'à l'ordinaire, son dernier « papier ». Il partait, le lendemain, pour Nancy, où il devait rejoindre le 226e régiment d'infanterie comme soldat de 2e classe. « Je sais que je ne reviendrai pas », me dit-il avec un sourire un peu triste. Le 22 août 1914, il disparaissait au combat de Courbesseaux (Meurthe-et-Moselle). Son corps n'a jamais été retrouvé. La croix de guerre et la médaille militaire lui ont été donnés à titre posthume. Un grand silence s'est fait sur son nom. Nous ne sommes plus que quelques-uns aujourd'hui à savoir que nous avons perdu le meilleur critique de notre génération, celui qui aurait été, parmi nous, le continuateur et l'égal d'un Jules Lemaitre. HENRI MASSIS. BIBLIOGRAPHIE UNE ÉTAPE DE LA CONVERSION DE HUYSMANS, d'après des lettres inédites à Mme de C***. (Dorbon, 1910 ; ce livre a été retiré du commerce sur la demande des exécuteurs testamentaires de Huysmans.) PAGES CHOISIES DE JULES LEMAITRE. (Nouvelle Librairie Nationale, 1911.) UNE ANNÉE DE CRITIQUE. (Dorbon, 1913.) L£ PETIT CARQUOIS, plaquette d'épigrammes en vers, en collaboration avec Jean Pellerin. (Le Divan, 1913.) De nombreux articles et essais qu'il faudrait réunir se trouvent dispersés dans les Marches de l'Est (1912 et 1913) ; La Revue Critique des idées et des livres (de 1910 à 1914) ; chronique dramatique : Akademos ; Le Divan, La Vie intellectuelle (de Belgique) ; L'Opinion (1913 et 1914), sans parler de ses chroniques, de ses articles, de ses contes du Matin, de L'Événement, du Gil Blas, et des notes qu'il publia dans une petite feuille qu'il avait fondée sous le nom de Paris-Coulisses.
[...] il me restait pour vivre des « papiers » sur les peintres, des échos, des comptes rendus d'exposition que Vauxcelles accueillait dans ses page» du Gil Blas. Vallette m'avançait, au Mercure, mes premiers droits d'auteur. J'étais aux anges quand juillet s'acheva dans la stupeur et la consternation. La guerre, l'horrible guerre éclata. Brusquement tout parut emporté, balayé. Au Gil Blas, avec Pellerin et André du Fresnois, une sorte d'ivresse nous saisit, nous jeta à la rue comme les autres et nous mêla ardemment a tant de jeunes hommes qui allaient, sans y croire, en chantant, à la mort. [...] les énormes vagues humaines conduites par leur destin s'avançaient, déferlant contre les magasins fermés, les cafés noirs de monde, et scandaient à pleine gueule sur un rythme à trois temps : « A Berlin ! A Berlin ! » — Et ramenez nos pendules, les gars ! braillaient des gens du peuple. A mesure que se succédaient sous nos yeux ces masses noires et gesticulantes de commis, d'employés, d'ouvriers, de bourgeois étroitement soudés les uns aux autres par un inexprimable enthousiasme, le jour baissait et dans une lumière grise, soulevant une épaisse poussière, d'autres cortèges débouchaient de toutes parts et emboîtaient le pas. « Les volontaires juifs » pouvait-on lire sur de vastes panneaux de bois hissés parmi des fanions des sociétés de gymnastique. On les saluait au passage. — Vivent les Juifs ! clamaient, sans distinction de classe ou de parti, les badauds. Jean Pellerin et moi nous regardâmes. — Oui, vivent les Juifs ! — Et vive la France ! jeta debout sur une chaise André du Fresnois. Il s'était découvert et très pâle, presque blême tant l'émotion lui étreignait le cœur, il suivait de ses yeux de myope ce défilé d'hommes de tout rang qui, répondant à l'approbation générale par de géantes clameurs, entonnait à l'approche de la. place de l'Opéra de ses mille voix enrouées et viriles : La Victoire, en chantant, nous ouvre la barrière, La Liberté gui-i-de nos pas. — André ! appela Jean... Du Fresnois ne l'entendit pas. Toujours debout sur sa chaise et tendu de tout l'être vers cette foule, — lui d'habitude si dédaigneux du nombre et régnant par l'esprit — il communiait avec elle, il consentait son propre sacrifice. Alors Jean Pellerin me saisit dans ses bras, me serra et très bas, désignant notre ami : — Regarde-le, dit-il... Regarde... Il ne reviendra pas ! — Mais si ! — Non, non, fit Jean que son pressentiment emplissait de détresse... Et il grimpa près d'André du Fresnois, sur le même siège, l'attira contre lui et durant près d'une heure le tint pressé si fraternellement que du Fresnois comprit peut-être et cessa de crier. A mes côtés, sourde aux applaudissements, qui de la terrasse du Napolitain crépitaient comme le feu nourri d'une compagnie de mitrailleuses, l'amie de du Fresnois se tenait immobile et muette. Eprouvait-elle aussi, dans cet affreux moment, l'impression qu'André serait bientôt tué ? Je n'osai parler mais lorsque mes deux camarades descendirent de leur chaise et se jetèrent vers nous, cette impression devint une certitude et nous nous séparâmes. Qu'on ne m'accuse pas d'écrire, hélas ! après la douloureuse disparition de du Fresnois, ces lignes. Il n'était déjà plus parmi nous ! Derrière son lorgnon aux verres troubles, le regard que je découvris, me frappa si étrangement qu'il me poursuit encore et me rappelle l'heure à laquelle il le fixa sur moi. Francis Carco, De Montmartre au Quartier latin, Albin Michel, 1927. |