| |
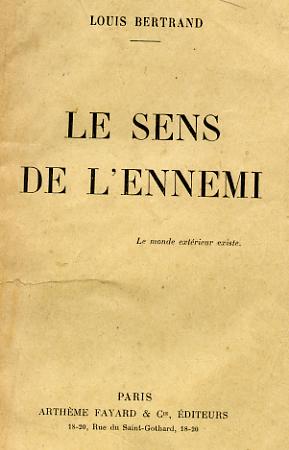
« Les deux Espagne », Le Sens de l'ennemi, Arthème Fayard, 1917, pp. 189-196
LES DEUX ESPAGNE
De Barcelone à Cadix, de Murcie à Santander, la Péninsule est, paraît-il, en ébullition. Nous n'avons rien à envier à l'Espagne, qui est en train de se lancer à fond dans l'anticléricalisme. Les partis avancés y réclament, à cor et à cri, la revision du Concordat, et la guerre y est déclarée, comme chez nous, aux congrégations. Des meetings ont eu lien dans tous les centres imposants. Des processions laïques ont parcouru les grandes artères de Madrid. Les femmes elles-mêmes s'agitent. Des adresses couvertes de signatures ont été envoyées à M. Canalejas pour l'encourager dans sa politique de résistance au Vatican. Enfin, le romancier Pérez Galdos, sans doute jaloux de la gloire d'Emile Zola, s'est mis à la tête du mouvement et réchauffe les enthousiasmes libres penseurs par des proclamations enflammées.
Et, d'autre part, on nous apprend que les catholiques résistent vigoureusement à la poussée anticléricale. Leurs meetings répondent à ceux de l'adversaire. Manifestations contre manifestations. Dames contre dames ! L'autre jour, quinze mille d'entre elles se sont réunies autour de l'évêché de Barcelone, pour protester contre les intentions du ministère. Quiconque est un peu au courante des choses de là-bas, sait que la victoire, — si victoire il y a, — sera chèrement achetée (1).
C'est que le catholicisme espagnol est autrement fervent et surtout autrement combatif que le nôtre. Ces hommes ont l'intrépidité que donnent les convictions absolues. Pour eux, en dehors de la vérité religieuse, il n'y a rien... Je me rappelle qu'au lendemain des désastres de Cuba, j'exprimai mes condoléances à un prêtre aragonais :
— Qu'importe ! me répondit-il superbement : l'Espagne est le pays du monde où il y a le plus de foi !
Il fallait entendre de quel ton et de quelle lèvre cela était dit !
Ainsi donc le sentiment que sa foi était partagée par la grande majorité de ses compatriotes suffisait pour faire oublier à ce bon Espagnol les défaites de la patrie. En cela, il ne s'illusionnait point. Les républicains et les socialistes eux-mêmes sont bien forcés de reconnaître qu'en Espagne le catholicisme détient une énorme influence. Par ses œuvres sociales, il a pénétré profondément dans les masses populaires. L'enseignement est presque tout entier entre ses mains. Il a des défenseurs convaincus dans l'élite intellectuelle de la nation. Enfin et surtout, il a pour lui son prestige séculaire, qui est à peine entamé.
Ce prestige a été jusqu'ici, tellement dominateur que sa diminution partielle fait présager aux esprits non avertis une véritable révolution de l'autre côté des Pyrénées. En tout cas, ils constatent que deux Espagne sont actuellement dressées l'une contre l'autre. Et ce fait leur paraît inouï, — précurseur des pires bouleversements. En réalité, il en a toujours été ainsi. La crise actuelle n'est qu'un épisode de la lutte qui se soutient, depuis des siècles, entre les deux moitiés de l'âme espagnole.
J'y songeais, ces jours-ci, en lisant un livre de haut style castillan, récemment traduit en français, et dont la lecture est singulièrement suggestive et attachante. Il s'agit d'un roman intitulé : La Gloire de Don Ramire. L'auteur, M. Enrique Larreta, qui est bien connu des lettrés parisiens, nous y raconte, avec une science des mieux informées et un rare don évocateur, précisément un épisode des luttes religieuses de la Péninsule, la dernière révolte des Morisques, sous le règne de Philippe II. C'est le suprême assaut de l'Islam africain et des sectes dissidentes contre le catholicisme monarchique et national : un des plus passionnants et des plus magnifiques sujets qu'un écrivain puisse choisir.
Le héros du livre symbolise tout ensemble l'Espagne catholique et celle des conquistadors. C'est l'homme de Foi, d'abord ardent à la volupté et forcené dans l'action. Mais que dis-je : l'action ? Ce mot a quelque chose de positif et de méthodique qui répugne à la libre fantaisie du pays de Don Quichote et de Don Ramire. C'est l'aventure qui est le vrai mot. Courir l'aventure, fût-ce en imagination, comme l'héroïque amant de Dulcinée, quel délicieux vertige ! On part, on suit le muletier, ou le contrebandier qui passe. On s'arrête dans des villages lépreux, mais aux noms sonores et aux murs transfigurés de soleil. Et puis, un beau soir, dans Cadix ou San-Lucar, on s'embarque sur une galère, comme le jeune Ramire. Les trois lanternes de poupe s'allument, et les navires prennent la grande route de l'Atlantique... Puis, la première fièvre de jeunesse et d'imagination une fois calmée, le réalisme foncier de la race prend sa revanche. A se froisser durement aux plus misérables réalités, le héros picaresque non seulement s'assagit, mais acquiert une vue plus juste et plus perçante des choses. La vanité de son effort, — et de tout l'effort du monde, — lui apparaît. Comme dans le tableau célèbre de Valdès Léal, il pèse tout au poids de l'éternité. Son réalisme radical en arrive à supprimer ce qui n'est que l'ombre de l'existence véritable. Après avoir épuisé les ivresses de l'action, le hidalgo éperdu de gloire ne peut plus aimer que celles de la Foi. Le coureur de monde n'a plus d'autre refuge que le Ciel. Et ainsi Don Ramire est non seulement un homme d'action, mais un réaliste qui va jusqu'au bout de la réalité.
M. Larreta ne l'entend pas précisément ainsi. Il insinue que son héros, une fois dépouillé de son prestige chevaleresque, n'est plus qu'un pauvre fou, halluciné de chimères, un fanatique à la cervelle étroite ; et, bien qu'il vise à l'impartialité de l'historien, il a des indulgences excessives pour ceux qui symbolisent l'autre Espagne, — l'Espagne islamique, aussi ennemie du catholicisme que de la royauté castillane et de l'unité nationale. Dieu me pardonne ! il nous représente presque les Morisques comme les champions de la Civilisation contre la Barbarie chrétienne !
Il faut connaître bien imparfaitement l'âme fermée et dure de l'Islam, pour se laisser aller à d'aussi décevants paradoxes. Je ne veux pas, ici, rechercher si, par exemple, les trop fameuses écoles de Cordoue furent autre chose que des officines de compilation et de mnémotechnie. Mais, quand on me parle du Maure agriculteur et quand on explique par son expulsion la stérilité de la Péninsule, je ne puis m'empêcher de penser à ce que le Maure musulman a fait de l'Afrique romaine, au désert que l'Islam installe partout où il passe.
Au fond, quand on pousse un peu les défenseurs du Turc, de l'Arabe on du Maure, leur dernier argument (et M. Enrique Larreta n'y a point manqué !) c'est que les Musulmans sont des gens qui se lavent, tandis que les chrétiens ne se lavent point. Supériorité bien discutable d'ailleurs, car tous ceux qui ont vécu en Orient savent que la propreté du Mousslim se limite strictement à son corps, ou à telles parties de son corps, — et qu'elle ne s'étend ni à son habitation, ni même, parfois, à ses vêtements. Le « sale chrétien » n'a pas eu besoin d'être averti par ceux de l'Islam pour apprendre à se laver. Toutes nos vieilles villes avaient, au moyen âge, leur Rue des Etuves. Et ces étuves sont un legs de la civilisation gréco-romaine, à laquelle les Arabes, — qui n'ont jamais rien inventé, — n'ont fait, en somme, que les emprunter.
J'insiste sur ces griefs, — malpropreté, paresse, obscurantisme, — parce que les ennemis du catholicisme espagnol les lui adressent encore aujourd'hui. Les anticléricaux d'outre-Pyrénées les répètent à satiété contre leurs compatriotes catholiques.
Or, tout proteste contre de pareilles calomnies. Les pamphlétaires qui dissertent a priori sur la paresse espagnole et qui en découvrent la cause dans le catholicisme, usent de mille détours sophistiques pour expliquer, par exemple, l'activité de Barcelone et de toute la Catalogne. D'après eux, si les Barcelonais travaillent, c'est évidemment parce qu'ils sont républicains et libres penseurs. Et voilà pourquoi votre fille est muette !
Que des écrivains à prétentions intellectuelles osent encore nous resservir cet argument de réunion publique, j'avoue que cela me passe ! Le catholicisme n'a rien à voir dans cette affaire. Quand les Espagnols ne travaillent pas, c'est qu'il n'y a personne pour les employer. Une telle inertie est malheureusement trop fréquente dans les régions pauvres de la Péninsule. Là, tout fait défaut : les ressources matérielles, les capitaux, l'initiative privée. On végète dans une médiocrité routinière et, en somme, fort plaisante, sans que la religion en soit le moins du monde responsable.
En réalité, sitôt que les Espagnols — indistinctement — sont mis dans les conditions requises pour travailler, ils accomplissent des tours de force dont nos Français ne sont plus trop capables. Moi qui avais contre eux tous les préjugés anglo-saxons, j'ai dû maintes fois proclamer qu'ils sont des travailleurs infatigables et qui défient à peu près toute concurrence. Je les ai vus à l'œuvre en Algérie et dans leur pays même : ces hommes sont admirables d'endurance, d'énergie et de sobriété.
Ce sont les jardiniers de Majorque qui ont créé toute la banlieue d'Alger. Et ce sont, en grande partie, leurs compatriotes de Valence et d'Alicante qui ont transformé le Sahel et le Tell algériens en un immense vignoble. Pour défricher, pour moissonner et pour vendanger, nos colons sont obligés de recourir à eux : aucun Français ne voudrait accepter un travail aussi pénible et aussi peu payé. Même en Andalousie, !a patrie classique de la paresse, ils se précipitent à la besogne, dès que le moindre appât de lucre leur est offert. Avec quel amour les mineurs d'Huelva collectionnent les beaux sterlings bien trébuchants, que la Compagnie anglaise leur verse chaque quinzaine ! Ces joueurs de guitare ne boudent ni le pic ni la pioche, pour peu qu'ils aient avantage à prendre de la peine.
J'ai vécu quelque temps dans un village perdu de la province de Valence : nos hôtes étaient assurément fort pauvres, mais je n'ai pas remarqué qu'ils fussent moins laborieux que nos paysans français. Ils étaient aux champs du matin au soir. Avec des outils et des moyens de transport rudimentaires, ils se donnaient beaucoup de mal pour un chétif résultat. Si misérable, néanmoins, que fut leur vie, ces gens simples et pieux y gardaient une décence que l'on ne connaît plus guère dans nos campagnes. Rude manœuvre, l'Espagnol se révèle, quand il le veut, un commerçant très entreprenant et très audacieux. Sans doute, ses procédés de négoce sont un peu barbares et arriérés comme ceux des Levantins — des Grecs, des Syriens, des Juifs et des Arabes. Nul ne s'entend comme lui à mettre une place en coupe réglée. C'est un négrier impitoyable qui a besoin d'être lâché dans la brousse coloniale, pour y pirater à son aise et y déployer toutes ses facultés. Mais, avec ses défauts — sa brutalité, sa ruse curthaginoise, ses instincts d'usurier (je parle surtout, ici, du colonial) — il excelle à capturer les banknotes et à édifier des fortunes souvent fort imposantes.
Laissons les cas individuels. Il est certain qu'il ne manque aux Espagnols pris en bloc que la volonté persévérante et surtout l'occasion d'exercer leurs naturelles aptitudes à toutes les formes de la vie pratique. Rien ne le prouve mieux que l'extraordinaire développement industriel de la Catalogue et des provinces cantabriques. Or, ces dernières sont parmi les plus catholiques de la Péninsule.
Les deux Espagne ne diffèrent donc pas, comme on voudrait nous le faire croire, par des qualités foncières qui seraient tout à l'avantage des libres penseurs. Il n'y a entre elles qu'une stérile dispute d'idées. Nous savons assez, nous autres Français, à quel affaiblissement des querelles de ce genre peuvent mener un pays.
(1) Le mouvement n'aboutit à rien et M. Canalejas fut, assassiné.
|