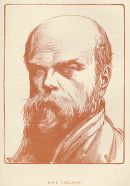| |

1. « Les Livres. Paul Verlaine », Mercure de France, février 1892
2. « Paul Verlaine », Le Livre des Masques, 1896
3. « Phrases sur l'art », Mercure de France, août 1899
4. « Un livre inédit de Verlaine », La Dépêche, Toulouse, 25 juin 1907
5. « Verlaine intime », La Dépêche, Toulouse, 12 août 1911
6. « La mort de Verlaine », La Dépêche, Toulouse, 18 août 1911
7. « Deux poètes », La Dépêche, Toulouse, 28 octobre 1913
8. « Verlaine », Promenades littéraires, 7e série, 1927
9. « La statue de Verlaine », Épilogues, 1903
10. « La mort de Verlaine », Promenades littéraires, 7e série, 1927
11. « Verlaine en pierre », Promenades littéraires, 7e série, 1927
12. « L'idéalisme de Verlaine », Promenades littéraires, 7e série, 1927
13. « Verlaine et Victor Hugo », Promenades littéraires, 1904
14. « Paul Verlaine », Le Temps, 14 novembre 1910 & Promenades littéraires, 4e série, 1912
15. « Verlaine en pierre », Épilogues, volume complémentaire, 1913
1. « Les Livres. Paul Verlaine », Mercure de France, n° 26, février 1892, p. 178
Paul Verlaine, par ALFRED ERNST (Extrait de la Nouvelle Revue). — Etude tout à fait excellente, et comme il est bien que M. Ernst ait évangélisé les barbares voués, en la revue où elle parut, aux vers de M. Chantavoine, et contents de ces petits pains au son !
2. « Paul Verlaine », Le Livre des Masques, Mercure de France, 1896
Paul Verlaine
M. Gaston Boissier, en couronnant (touchante coutume) un poète quinquagénaire, le félicitait de n'avoir pas innové, d'avoir exprimé des idées ordinaires en un style facile, de s'être conformé avec scrupule aux lois traditionnelles de la poétique française. Ne pourrait-on rédiger une histoire de notre littérature en négligeant les novateurs ? Ronsard serait remplacé par Ponthus de Thyard, Corneille par son frère, Racine par Campistron, Lamartine par M. de Laprade, Victor Hugo par M. Ponsard et Verlaine par M. Aicard ; ce serait plus encourageant, plus académique et peut-être plus mondain, car, en France, le génie semble toujours un peu ridicule.
Verlaine est une nature, et tel, indéfinissable. Comme sa vie, les rythmes qu'il aime sont des lignes brisées ou enroulées ; il acheva de désarticuler le vers romantique et, l'ayant rendu informe, l'ayant troué et décousu pour y vouloir faire entrer trop de choses, toutes les effervescences qui sortaient de son crâne fou, il fut, sans le vouloir, un des instigateurs du vers libre. Le vers verlainien à rejets, à incidences, à parenthèses, devait naturellement devenir le vers libre ; en devenant " libre " il n'a fait que régulariser un état.
Sans talent et sans conscience, nul ne représenta sans doute aussi divinement que Verlaine le génie pur et simple de l'animal humain sous ses deux formes humaines : le don du verbe et le don des larmes.
Quand le don du verbe l'abandonne, et qu'en même temps le don des larmes lui est enlevé, il devient ou l'iambiste tapageur et grossier d'Invectives ou l'humble et gauche élégiaque de Chansons pour Elle. Poète, par ses dons mêmes, voué à ne dire heureusement que l'amour, tous les amours, et d'abord celui dont les lèvres ne s'inclinent qu'en rêve sur les étoiles de la robe purificatrice, celui qui fit les Amies fit des cantiques de mois de Marie : et du même cœur, de la même main, du même génie, mais qui les chantera, ô hypocrites ! sinon ces mêmes Amies, ce jour-là blanches et voilées de blanc ?
Avouer ses péchés d'action ou de rêve n'est pas un péché ; nulle confession publique ne peut scandaliser un homme car tous les hommes sont pareils et pareillement tentés ; nul ne commet un crime dont son frère ne soit capable. C'est pourquoi les journaux pieux ou d'académie assumèrent en vain la honte d'avoir injurié Verlaine, encore sous les fleurs ; le coup de pied du sacristain et celui du cuistre se brisèrent sur un socle déjà de granit, pendant que dans sa barbe de marbre, Verlaine souriait à l'infini, l'air d'un Faune qui écoute sonner les cloches. (Le Livre des Masques, Mercure de France, 1896.)
3. « Variétés. Phrases sur l'art », Mercure de France, août 1899, pp. 564-569 [texte disponible sur Gallica]
Ce texte est annoncé dans le sommaire sous le titre de « Verlaine » ; il a été recueilli sous le titre de « L'art et le peupe » dans Problème du style (1902).
8. « Verlaine » [février 1896], Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927
Verlaine en pierre. — La gloire de Verlaine a été peu insultée, sinon par un sacristain qui a osé écrire dans le Monde que Sagesse ne fut qu'une œuvre de réclame, par quoi le poète voulait (comme M. Zola y réussit au moyen du Rêve) s'ouvrir un public nouveau. Que les benjamins de Léo Taxil éructent de si turpides blasphèmes, serait-ce matière à indignation ? Ou bien serait-il digne de leur prouver qu'ils mentent ? Ici, non. A l'heure actuelle, s'il y a parfois dans la poésie française une odeur d'encens, c'est dans la navette de Sagesse que les grains furent puisés. Navette et ciboire aussi : c'est la fête du pain... Mais tant mieux s'ils nient Verlaine, ces imbéciles qui pourraient en réclamer la moitié : ainsi nous le garderons tout entier pour nous.
9. « La statue de Verlaine », Épilogues. Réflexions sur la vie. 1895-1898, Mercure de France, 1903
37
La statue de Verlaine. — M. Fouquier, que l'on croyait calmé, s'est réveillé tout, comme le serpent caché sous les feuilles mortes, — et il a lancé son venin sur le pauvre Lélian. Venin perdu, mais quel joli ton de mépris protecteur dans cette phrase d'un journaliste parlant d'un grand poète: « Nos voies furent différentes ».
10. « La mort de Verlaine » , Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927
La mort de Verlaine. — Claudien le disait bien, pensant à autre chose, mais les vers des poètes sont à métamorphoses :
Fallax ô quoties pulvis deludet amorem.
La poussière se joue de nos amours et nos amours s'en vont en poussière. Il s'agit de Verlaine. Un journaliste nommé, dit-on, Nyon l'appela « peu », un autre l'appela « honte », un autre l'appela « sans-chemise », et M. Zola, enfin, l'appela « raté ». A ce propos, cet homme de lettres bien connu énuméra quelques ratés célèbres, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Jules Laforgue, et d'autres dont il ne dévoilera le nom qu'au jour de leurs misérables funérailles. M. Zola sait plusieurs choses et d'abord que le grand écrivain se distingue de ses moindres congénères par cela, qu'il est décoré, et ceci, qu'il est académicien. Cela est le prodrome et ceci est le symptôme. Les conditions qui font qu'on n'est pas un grand écrivain sont les ci-dessus, négatives, et une autre, non moins négative, que les œuvres de ce pauvre ne se vendent pas. Il croit qu'on n'a jamais vendu, de Verlaine, que son billet d'enterrement, cinquante centimes, par les soins de M. Vanier ; M. Zola se trompe et d'autres se trompent : quoique les œuvres de Verlaine se vendissent à des prix de fleurs rares, elles se vendaient ; entre les mains d'un éditeur sérieux, lié par les termes d'un traité, avec quelques précautions et de la surveillance, les œuvres de Verlaine eussent rapporté au poète plus d'argent qu'il ne lui en fallait pour mener, heureux, la modeste mais sûre existence qu'il aurait voulu mener, même parmi les absinthes et parmi les parasites. Les aumônes que de généreux amis dispensèrent à Verlaine n'auraient pas dû être nécessaires : son éditeur pouvait pourvoir à sa vie stricte ; ses camarades du Parnasse, quelques-uns riches et puissants, devaient assurer le luxe de cet unique, — en ne lui fermant pas, par jalousie ou par peur, les journaux où ils prennent leurs ébats. On a vu cela : les Mendès, Coppée, Lepelletier, étalés à trente et quarante sous la ligne dans le premier salon de ces riches maisons, et Verlaine rejeté à la troisième page, parmi les faits divers et les pauvres : on lui jetait deux louis et le conseil de ne pas abuser. Mort, ces camarades excellents surgirent et firent savoir au monde que leurs yeux, tout à coup, étaient devenus rouges ; ils ne le disaient pas, mais leurs joues aussi étaient devenues rouges. Oh ! ils ne l'avaient pas abandonné ; ils lui faisaient l'aumône, pourvu qu'il prît, allant vers eux, l'escalier de service. Le peu d'argent que gagnait Verlaine, il le gagnait en Angleterre, en Hollande, en Belgique, par des articles de magazine, des conférences ; ses camarades ne le poursuivaient pas si loin ; le poursuivaient-ils ? Non, il serait absurde de prétendre qu'ils le détestaient; ils l'ignoraient ou l'aimaient — silencieux ; ou bien encore, ils n'osaient braver, pour Verlaine, la malveillante ignorance des salles de rédaction. Alors, presque le seul argent, non aumône, que recevait Verlaine, lui venait de l'Etat : le ministère qui chargeait d'un collier pourpre la peau saurée de M. Dumas le fils consentait au poète de Sagesse des secours, non pas aumône, — secours. Des crédits sont à cet effet budgetés et dus, par fragments, à tout homme de lettres indigent.
Et oserait-on affirmer que l'Académie, qui « décerna » à M. Coppée, il y a trois mois, un prix de cinq mille francs, avec une couronne et des encouragements, — oserait-on affirmer que l'Académie française n'a jamais, en secret, offert à Verlaine quelque lambeau de prix périmé et inutilisable ? Ce serait mal évaluer ces quarante grands cœurs.
Cependant, nous venons d'enterrer un roi de Bohême, tout nu, tout pauvre, vêtu de sa seule gloire.
11. « Verlaine en pierre », Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927
Verlaine en pierre. — Statues, bronze, marbre, mais l'on oublie la terre cuite (aussi par les siècles) des vieux sarcophages, la brique rouge et rude des Etrusques ou vernie des Babyloniens ; on oublie le granit des calvaires bretons et la pierre des basiliques, la pierre si douce, si tendre, si confiante, si sœur, qu'elle laisse l'homme écrire sur elle comme avec un stylet sur de la cire. Je voudrais de M. de Niederhausen un Verlaine en pierre comme Notre-Dame, comme Saint-Julien le Pauvre, comme Saint-Pierre de Caen, — car il eut en son génie l'amour comme Marie, la pauvreté comme saint Julien et le doute comme saint Pierre. Et je demande encore que l'on nous fasse enfin un Verlaine selon nos vraies traditions, — non plus le Faune, trop facile, ni le Socrate, trop hypocrite, mais le Donateur, tout pareillement aux vieux panneaux ou reliefs, un pécheur tout simple, tout heureux d'être absous par une peinture ; et qui récite avec humilité des litanies et, ici, avec amour les plus beaux cantiques de la langue française. Mais M. de Niederhausen ne fera pas cela nul statuaire à cette heure ne saurait ériger une âme visible ; cela passerait même pour un peu ridicule. L'imitation des placidités grecques a tué, voilà trois siècles, la sculpture expressive, l'art familier qui disait si franchement l'essentiel de la vie. En ces trois siècles, jusqu'à Rodin, la sculpture française a produit cinq ou six morceaux imposants, et c'est tout, aucune de ces pages de marbre n'ayant d'ailleurs l'émouvante beauté des choses traditionnelles, des choses que le sang, autant que l'esprit, aime et comprend.
12. « L'idéalisme de Verlaine », Promenades littéraires, 7e série, Mercure de France, 1927
L'idéalisme de Verlaine. — Les mésaventures du buste que l'on veut de cette face socratique ont obligé même les bouches hostiles à parler de Verlaine. La mort du journaliste Fouquier, un de nos meilleurs insulteurs, a été une occasion aussi. On a rappelé le mot spirituel de cet homme délicieux (qui tira des larmes à M. Mendès, Quo non ars penetrat ? discunt lacrymare decenter. — lui-même), le mot délicieux de cet homme spirituel : « Quel dommage qu'il ne soit pas mort à l'hôpital ! »
Non, ce ne fut pas à l'hôpital, comme il convenait, que mourut Verlaine, mais dans une petite chambre comme celles où viennent dormir les ouvriers aisés et honnêtes. Et je me souviens, comme nous revenions de contempler le masque apaisé, Mallarmé admirait la puissance d'idéalisme que certifiait une pauvreté aussi simple : à nous, disait-il, même dénués, il faudrait on ne sait quoi de particulier, une fleur, un dessin aimé, un beau livre, de ces riens où se pose le regard et qui, comme une pierre au milieu du ruisseau, aident à franchir l'espace entre le rêve et le réel. Verlaine, par la force d'un idéalisme supérieur, franchissait d'un bond la distance pénible ; ou bien il créait autour de lui un invisible réel, comme en ses vers, un visible rêve. Ceci pourrait certifier la sincérité de ses crises mystiques : il était capable, étant dans une prison, de se créer un paradis et de vivre en paradis.
Il faut que les Fouquier en soient pour leur honte — celui qui est mort et ceux qui le continuent : un poète comme Verlaine, de sa qualité d'imagination, ne meurt pas à l'hôpital, mais dans le palais qui, à sa volonté, monte autour de son lit blanc ; et il y a des hommes qui, mourant dans un palais, meurent sur le fumier.
13. « Verlaine et Victor Hugo », Promenades littéraires, Mercure de France, 1904
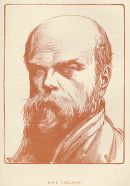
VERLAINE ET VICTOR HUGO (1)
La littérature, qui n'est cependant pas un pays habité par des gens simples, est pleine des plus naïves légendes. C'est ainsi que l'on croit généralement que tous les grands écrivains d'une période ont vécu dans un état de parfaite amitié ou, tout au moins, de profonde estime réciproque. Les professeurs de second ordre, qui n'estiment les lettres que comme une école de morale, une méthode éducatrice, n'hésitent pas à nous décrire les sentiments d'admiration respectueuse qu'éprouvaient l'un pour l'autre Molière et Racine, Boileau et La Fontaine, et même Bossuet et Fénelon, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Il faut, à tout prix, insinuer aux enfants et au public, ce grand enfant, que le génie est toujours accompagné de la vertu, de toutes les vertus. Ces éducateurs audacieux n'ont ils pas été jusqu'à faire de George Sand le modèle des mères de famille, la « bonne dame » par excellence, une sorte de madone laïque ? Quant à Victor Hugo, il est convenu que tous ses contemporains l'ont admiré, l'ont adoré ; qu'il ne rencontra jamais un contradicteur, sinon dans la plus basse classe des politiciens ou des littérateurs ; qu'il fut un dieu, devant lequel les bons esprits du dix-neuvième siècle se trouvaient honorés d'être admis à agiter l'encensoir.
Le culte de Victor Hugo, cependant, s'il a existé réellement, pratiqué surtout par des parasites pieux, qui vivaient de cet autel, a toujours rencontré de nombreux contradicteurs. On peut admirer un homme et le tenir pour un grand poète, sans se croire tenu de tomber à genoux devant lui ou de se découvrir quand on prononce son nom, ainsi que faisaient les Espagnols autrefois quand ils nommaient Dieu ou le Roi. On n'aime pas beaucoup en France de telles exagérations ; on les juge de mauvais goût. Les thuriféraires de Victor Hugo l'auraient rendu ridicule, si cela était possible : le ridicule est retombé sur eux, et c'est au milieu d'un enthousiasme assez modéré qu'on a inauguré l'autre jour le musée, assez pauvre, que de braves gens ont voulu consacrer à sa mémoire.
Malgré la profonde influence que le romantisme a exercée sur l'esprit français, il est resté classique, ami de la mesure, de la règle, d'une simplicité digne. Il serait difficile de faire croire à ceux qui ont gardé quelque sens de la tradition et de la vérité historique, que la littérature française se résume tout entière en Victor Hugo, qu'il n'y avait rien avant lui et qu'il n'y aura rien après. La littérature française compte présentement neuf siècles d'existence ; elle a fait et refait plusieurs fois l'éducation de l'Europe : un homme, si grand qu'il soit, un Victor Hugo lui-même, ne tient que sa place dans un cycle aussi immense ; il ne remplit pas le cycle tout entier.
Une telle appréciation ne satisfera pas les dévots littéraires dont la manie est de ramener tout à Victor Hugo, d'en faire le centre, sinon du monde, du moins de la pensée française au dix-neuvième siècle. Ils ne sont pas loin, ces dévots, de considérer comme des malfaiteurs ceux qui gardent, en face du colosse, la pleine liberté de leur jugement. Mais le plus souvent, affligés dans leur piété, ils se bouchent les oreilles, pour ne pas entendre les blasphèmes ; ou bien ils feignent de ne pas avoir compris. Ici se place l'histoire des opinions de Verlaine sur Victor Hugo. Elle est assez curieuse. Verlaine avait-il une grande admiration pour Victor Hugo ? Oui, disent les fanatiques ; non, disent ceux qui ont connu Verlaine et qui se souviennent de ses conversations.
La question serait restée douteuse, faute de témoignage écrit, si l'on ne venait précisément de publier les œuvres posthumes de Verlaine ; on y trouve, très franchement exprimée, l'opinion du poète de Sagesse sur le poète des Orientales. Verlaine reconnaît d'abord que, dans ses causeries avec ses amis, il a parfois maltraité Victor Hugo, plus que de raison. Sans renier absolument ces propos improvisés, il ne veut pas répéter, au moins sous leur forme brutale et malveillante, « ces boutades irréfléchies » ; il a relu plusieurs des œuvres du grand poète et il prétend, cette fois, « faire une profession de foi publique équitable ».
Verlaine était spirituel, et non sans quelque méchanceté, quand il parlait dans l'intimité ; quand il écrivait, il rentrait sa méchanceté, et trop souvent aussi, hélas ! son esprit. C'est un prosateur, non pas médiocre, car il demeure toujours original, mais gauche, lourd. Cela l'ennuie d'écrire des articles ; il a hâte d'en finir ; il dit n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête, en des phrases contournées, lentes, boiteuses. Parler de Victor Hugo l'embarrasse visiblement ; il a plus de choses à dire qu'il n'en peut et qu'il n'en veut dire. On le sent partagé entre une admiration ancienne et une antipathie récente.
Ceux qui sont étonnés de cette attitude ont fait preuve d'une assez grande naïveté. Les amitiés littéraires sont en effet nécessairement basées sur la communauté des opinions, des goûts, des esthétiques : or Verlaine était absolument, en art, à l'opposé de Victor Hugo.
La poésie de Victor Hugo, c'est de l'éloquence. Les sentiments les plus simples, il les enveloppe en des flots de sonorités. Il n'est jamais banal, mais il n'est jamais naturel : il cherche toujours à produire un effet. C'est un orateur qui récite d'harmonieuses phrases, qui scande de belles périodes. Quel est l'un des premiers articles de l'Art poétique de Verlaine ? Ceci, tout simplement : « Prends l'éloquence et tords-lui son cou. » Victor Hugo est le rénovateur de la rime riche ; ses vers reposent sur la rime : il est le virtuose ; nul n'a eu, à un pareil degré, ce génie de la rime, cet art de prendre deux mots très éloignés de sens, très voisins de son, de les battre l'un contre l'autre comme des cymbales et d'en tirer, en plus de la musique, quelque chose de vague et de mystérieux qui donne l'illusion d' une pensée. Que dit Verlaine de la rime ? Il la méprise. Il jette par la fenêtre « ce bijou d'un sou ».
Victor Hugo procède par de longues antithèses qui n'ont de valeur que maniées par lui, que revêtues de la magnifique parure verbale qu'il est capable de créer, qui ne sont supportables que grâce à son habileté extrême à filer les phrases et les raisonnements. Verlaine encore dédaigne cela ; à ces couleurs crues qui se coupent brutalement, il oppose la nuance : « Nous voulons la nuance encore ; pas la couleur, rien que la nuance. »
Après s'être posé ainsi, devant Victor Hugo lui-même, en chef d'une école nouvelle, pouvait-il vraiment l'admirer sans restrictions ? Cela eût été absurde ou hypocrite.
Voici donc ce que dit Verlaine : « Les Orientales me plurent à quinze ans (j'y voyais des odalisques), et me plaisent encore, comme beau travail de bimbeloterie « artistique », comme article de Paris pour la rue de Rivoli... » La partie de l'œuvre de Victor Hugo qui lui semble la meilleure et la plus durable, c'est celle où le poète, jeune et amoureux, montre le plus de simplicité, où il semble avouer de sincères émois, et en particulier, les Rayons et les Ombres, malgré la puérilité de l'antithèse. Il a gardé une tendresse pour ces poèmes de demi-teinte, de « nuances », avec leur musique discrète, comme en sourdine. Quant aux œuvres de déclamation poétique, aux Contemplations, par exemple, il avoue qu'après y avoir pendant longtemps rien compris du tout, il est arrivé à les comprendre trop. Ce qu'il admire peut-être le plus, ce sont les romans et surtout les drames ; mais il prétend que Victor Hugo n'a presque jamais pu créer, sauf peut-être Esméralda et Éponine, une figure de femme vraiment vivante. Ici, il est particulièrement dur : « Quelles petites horreurs fadasses et bébêtes que toutes ces jeunes filles ! » Et il cite surtout la « stupide » Déa, de Torquemada, l'« ennuyeuse » Deruchette et l'« insupportable » Cosette, des Misérables.
L'article est très court et passablement obscur. Verlaine n'y a pas dit toute sa pensée, mais on peut la restituer : il n'aimait pas Victor Hugo, dans lequel il ne voyait qu'un ancêtre très lointain, d'un intérêt purement historique. Et, de fait, l'influence de Victor Hugo sur Verlaine fut vraiment, nulle : presque seul de ses contemporains, il a échappé à la domination du grand, du trop grand poète. Son véritable maître, c'est Théodore de Banville. Il l'a reconnu lui-même (2) : la lecture des Cariatides et des Stalactites « frappèrent littéralement d'admiration et de sympathie mes seize ans déjà littéraires ». Et il continue, disant : « Il y a dans ces poèmes une telle ardeur, une telle fougue, une telle abondance, une telle richesse en quelque sorte, que je ne crains pas d'affirmer qu'ils exercèrent sur moi une influence décisive. »
On ne peut rien ajouter à cet aveu. Le premier maître de Verlaine fut Banville ; le second fut Baudelaire ; le troisième fut lui-même.
Et quel avait été le maître de Victor Hugo ? Un poète bien oublié aujourd'hui, mais doué cependant d'une sorte de génie de transition, Alexandre Soumet. De 1818 à 1822, il le célèbre sur tous les tons dans ses lettres :
« Alexandre Soumet vous dit des choses tendres. Il fait ici des vers admirables et se porte mal. » Il admire surtout son théâtre : « Alexandre, qui est toujours malade ou paresseux, a cependant terminé Saül, que je préfère à sa Clytemnestre, que je préfère à tout ce qui a paru sur notre scène depuis un demi-siècle. J'attends avec bien de l'impatience la représentation de l'une ou l'autre de ces belles tragédies... Je désirerais vivement que Saül fût joué le premier ; cet ouvrage, entièrement original, sévère comme un drame germanique, révélerait du premier coup toute la hauteur de Soumet... » Et encore : « Soumet va être joué presque à la fois aux deux théâtres, c'est-à-dire qu'il va obtenir deux triomphes. Il a fait à son chef-d'œuvre, Saül, de très beaux changements. Vous verrez, je vous promets que vous serez aussi heureux de la beauté de l'ouvrage que de l'auteur. Saül et Clytemnestre sont à mes yeux les deux plus belles tragédies de l'époque et ne le cèdent en rien aux chefs-d'oeuvre de notre scène, en rien. »
Comment l'admirateur du Saül de Soumet (1822) devint-il l'auteur de Cromwell (1827), c'est ce que l'on n'a pas encore très bien expliqué.
(1) Paul Verlaine, œuvres posthumes. Paris, Librairie Vanier.
(2) œuvres posthumes, p. 189.
[entoilage : Michel Dorenlor et Christian Buat, octobre 2000]
|
Mardi 15 Novembre [1910]. – Dans Le Temps d'hier soir, un second article de Gourmont, sur ses souvenirs sur le Symbolisme. Article consacré à Verlaine. Je ne l'ai pas lu. On en a parlé ce matin au Mercure. II paraît que Gourmont y montre tous les mauvais côtés de Verlaine. Que de fois, au reste, ne me l'a-t-il pas traité, en m'en parlant, de bandit. « Verlaine ! Le doux Verlaine ! C'était un bandit, un bandit, mon cher ! »
Vallette nous a donné ce détail. Il y a quelques années, ou seulement quelques mois, peut-être, Gourmont lui avait apporté un article sur Verlaine, pour le Mercure. Il s'y montrait déjà très dur. Comme on commençait à s'occuper de la question du monument, la chose parut un peu intempestive à Vallette. Il refusa l'article à Gourmont. Un article refusé à Gourmont ! Gourmont reprit son manuscrit, avec ces simples mots : « C'est bien. Je le ferai plus méchant. » (Paul Léautaud, Journal littéraire)
|
14. « Paul Verlaine », Le Temps, 14 novembre 1910 & Promenades littéraires, 4e série, 1912
PAUL VERLAINE
Paul Verlaine fut l'autre consul du symbolisme. Je n'établis point de prééminence. Tous les deux furent aimés follement, Mallarmé avec plus de respect, Verlaine avec plus de familiarité. La première fois que je l'aperçus, ce fut à la Bibliothèque nationale, bon endroit pour dépister les grands écrivains, car ils y passent presque tous, quelque jour, mêlés à la troupe laborieuse. Sa figure, même si sa fiche nominative ne l'eût désignée à mon attention, m'eût frappé. C'était celle que je m'imaginais du Suève ou du Hun, de ces formidables barbares qui épouvantaient si fort Sidoine Apollinaire et qu'il n'a décrits qu'en tremblant. L'impression n'était pas si mauvaise. Ne venait-il pas de ravager l'art poétique à peu près comme ils avaient ravagé la majesté romaine ? Je ne le revis plus que dans les cafés et sur les trottoirs du boulevard Saint-Michel. Il ne quittait plus le quartier, après une vie trop singulière, que pour le refuge lointain et bienveillant des hôpitaux, où le jetait sa santé aventureuse. Sa destinée s'achevait, après l'apothéose de 1891, au Vaudeville, dans une sorte de calme tremblotant, au milieu d'amis trop familiers, d'admirateurs trop curieux. On venait respirer dans son présent l'odeur de son passé.
Les cafés ne furent jamais tant à la mode. Un photographe, publiant Nos écrivains chez eux, établit Verlaine au café de la Source, près d'une absinthe. Quel contraste avec la somptueuse bibliothèque de la même série, où, dans les peaux d'ours, à l'ombre des lampadaires, M. Ohnet se rendait visible aux foules ! Un coin de table et pour tout appareil le haut verre étroit, la carafe frappée, l'encrier, la plume et le buvard : tel était le cabinet de travail du dernier grand poète français. S'il n'y fit pas ses meilleurs vers, c'est que l'absinthe peut-être était plus tentante que les feuilles de papier à lettre. J'ai une photographie du tombeau d'Edgar Poe où se détache en lettres énormes, au mur d'une maison voisine du cimetière : Liquor. Ce mot fatidique, alcool, plane au-dessus de la vie du pauvre Lélian. Sa vie, pourquoi ne pas en dire même les mauvais épisodes ? On raconte bien celle de Villon, qui fut un voleur de grand chemin, un échappé de la hart, et cela n'a jamais prouvé qu'une chose, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la moralité et le génie. « Qu'il soit plutôt un assassin et qu'il ait du talent ! » disait doucement Huysmans, devant les mauvais vers et la conduite dévouée d'un jeune poète. L'excès du paradoxe contient une vérité. On peut le trouver immoral, mais c'est un fait, que l'existence nous enseigne avec persévérance et qu'il a bien fallu accueillir, que les vies peuvent être basses et les œuvres hautes. La méthode de Sainte-Beuve et de Taine est ici en défaut et je n'ai jamais su par quoi la remplacer. A moins qu'il ne faille croire que les jugements des hommes sur la moralité, soient fort incertains, à moins qu'il ne faille lire la nature en se plaçant, comme Nietzsche, au-dessus du bien et du mal. Et puis - et ceci, du moins, n'est pas incertain - il y a une fatalité physiologique. C'est ce qu'il faudra se dire en contemplant dans le jardin du Luxembourg le mystère de la figure rude, aux dessous de douceur, de ce grand enfant où se joignaient la brutalité des instincts du mâle et la faiblesse d'une femme aux nerfs alanguis. Il fut tout cela ; il fut le petit enfant qui récite pieusement sa prière et le faune qui rôde, pareil à l'ogre ; il fut sainte Thérèse, ivre d'amour divin, et aussi Sapho, qui n'aimait que ses pareilles ; il fut le rêveur attendri des tombées de nuit d'automne, qui frissonne à l'écharpe fuyante comme à la tournoyante feuille, et il fut aussi le mauvais galant qui s'endort dans les tavernes. Verlaine fut fraternel à tous les sentiments et à toutes les sensations.
Je ne sais comment lisent ceux qui n'ont vu dans les Poèmes saturniens que des exercices poétiques, que d'impersonnelles notations. Qu'il ait eu l'intention d'obéir à la règle d'impassibilité voulue par Leconte de Lisle, c'est possible ; mais sa nature s'y refusa. Sa sensibilité déjà débordait. Sa muse est une statue, sans doute, mais qui parle :
Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Toutes les poésies de Verlaine sont en bourgeon, et les feuilles déjà visibles, dans ces Poèmes saturniens ; certaines libertés prosodiques, dissimulées çà et là, me font douter qu'il ait jamais été un parnassien véritable, au fond de son cœur, au fond de ses nerfs. Celui qui se pâmait à entendre
Les sanglots longs
Des violons,
n'était pas parnassien, ni celui qui tressait à l'amour de nouvelles métaphores,
Baiser ! rose trémière au jardin des caresses !
ni celui qui écrivait, prélude de son futur art poétique :
De la douceur, de la douceur, de la douceur.
Ce volume, édité en même temps que le Reliquaire de François Coppée, n'eut naturellement aucun succès. On le vit en vain, longtemps, à la vitrine de Lemerre, passage Choiseul, parmi les eucologes du successeur de Percepied, marchand de chapelets. Un jour, après le Passant, le Reliquaire (marchandé parfois, à cause de son titre) s'enleva. Les Poèmes saturniens restèrent, attendant leurs sœurs, les Fêtes galantes, qui vinrent les rejoindre trois ans plus tard, en 1869, et n'eurent pas un destin meilleur. Verlaine, malgré que ses amis le missent au premier rang des poètes nouveaux, devait rester inconnu du public jusqu'en 1884 ou 1885, année de Jadis et Naguère.
Pauvres Fêtes galantes, qu'elles tombaient mal en ce moment de débats politiques, d'émeutes, à la veille de la guerre et de la Commune ! En 1871, une mentalité nouvelle avait surgi. Était-ce le moment de songer
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres ?
Était-ce le moment de se redire, sous les horizons encore sanglants et enflammés :
Le soir tombait, un soir équivoque, d'automne;
Les belles, se pendant rêveuses à nos bras,
Dirent alors des mots si spécieux tout bas
Que notre âme depuis ce temps tremble et s'étonne ?
Tout au plus aurait-on pu murmurer, frissonnant encore de la peur ancienne :
Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes tout à l'heure ont passé...
Mais on ne murmurait rien de tel, et pour que les paroles de Verlaine, congelées par un terrible hiver politique, retrouvassent leur son et leur accent, il fallait que les petits enfants de vers 1860 eussent atteint l'âge d'homme et que parût, avide enfin de quelque chose qui sentit une odeur d'art, une génération lassée d'avance des lourdes querelles politiques et sociales.
Entre temps, Verlaine avait vécu. Deux ans avant les Poèmes saturniens, il était entré à l'Hôtel de Ville, où il trouvait dans les bureaux Lafenestre, Velade, Mérat, poètes aussi, et beaucoup d'après-midi se passaient, au café du Gaz, en fiévreuses causeries d'art. Il admirait alors Leconte de Lisle et semblait très frappé par les poèmes précieux que publiait au Parnasse contemporain le jeune Stéphane Mallarmé. Comme plus tard Albert Samain, qui lui succéda à l'Hôtel de Ville, il ne daigna dépasser le grade d'expéditionnaire, quoiqu'il eût fait de fort bonnes études, et c'est en cette qualité qu'il demeura là jusqu'à l'incendie. N'ayant pas osé se représenter aux bureaux reconstitués au Luxembourg, il passa pour communard, et ce fut la première des légendes qui pesèrent sur sa vie, et la plus grave, celle qui, le jetant dans une sorte d'errance et de misère, le prédisposa aux mauvaises aventures. Les années de bureau de Verlaine furent les seules bonnes années de sa vie. Appuyé sur une sécurité médiocre, mais tout de même une sécurité, il s'était marié par amour. Tout ce que sa jeune poésie avait de plus divin, il croyait en avoir trouvé la réalisation même dans Mathilde Mauté de Fleurville, la demi-sœur du musicien Charles de Sivry :
En robe grise et verte avec des ruches,
Un jour de juin que j'étais soucieux
Elle apparut...
Le coup de foudre fut réciproque. Agréé, Verlaine vécut dans une féerie, en attendant l'heure. C'est l'expression de son attentif ami et biographe, M. Edmond Lepelletier. Verlaine, n'avait encore connu ni l'amour, ni la liaison, ni le caprice. Sa jeunesse, farouche comme celle d'un dieu, mais moins chaste, n'avait bu qu'aux sources du hasard, soudain jaillissantes au coup de pied du désir. La jeune fille l'enivrait d'une ivresse inconnue qui se suffisait à elle-même. Il en oubliait les alcools, il redevenait lui-même, l'être naturellement doux, rêveur, un peu craintif, un cœur d'enfant. Si timide, qu'il fit sa cour par lettres, par lettres qui étaient des vers, qui devinrent la Bonne Chanson ! Comme un Sully Prudhomme, il y chantait la poésie du devoir :
Ce sera le devoir heureux aux gais combats...
Il se maria au bruit des premiers coups de canon, encore lointains, et l'année terrible fut pour lui 1'année heureuse.
Cependant, favorisé par le désœuvrement du siège, la vie du corps de garde, le démon de l'alcool reprit possession de Verlaine, en même temps qu'un autre démon, plus terrible encore peut-être, entrait dans son existence : Arthur Rimbaud. Ce fut la séparation : Verlaine s'éloigna de la femme qu'il avait tant aimée et qu'il ne devait plus revoir. En 1872 il emmenait Rimbaud. Qu'était-ce donc que ce Rimbaud ? Hélas ! Rimbaud était sinon un grand poète, lui aussi, un des poètes les plus évidents entre ceux qui parurent alors. Ce gamin de génie qui n'écrivit qu'entre seize et vingt ans, puis disparut si bien qu'on le crut mort, fut un jeu de la nature, lusus naturæ, comme on disait autrefois des cailloux biscornus ou des pétrifications folles. Sortant du collège de Charleville, il débarqua frauduleusement à Paris, en février 1871, et pénétra indûment dans l'atelier d'André Gill ; de là, grossier, mal élevé, impertinent, brutal et sauvage, s'introduisit dans le monde littéraire où il provoquait une sorte de stupeur. On pouvait le haïr non le mépriser, car l'enfant vicieux récitait des poésies d'une nervosité incroyable, d'une hardiesse miraculeuse, d'un intense coloris, les Premières Communions, les Assis, le Bateau ivre. Ces morceaux et les autres furent publiés trop tard pour avoir une réelle influence littéraire, mais ils témoignent d'une singulière, d'une mûre précocité. Un de ces vers s'est redit longtemps en manière d'ironie :
Avec l'assentiment des grands héliotropes.
Ceux-ci sont plus vrais qui révèlent la profonde mélancolie de ce mauvais garçon de génie :
Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes,
Toute lune est atroce, et tout soleil amer...
Son fameux sonnet des Voyelles, qu'on cita dans le temps comme un type de poésie décadente, révéla aux praticiens de la psychologie physiologique le phénomène, pas très rare, de l'audition colorée. Il s'est élevé, depuis vingt ans, une montagne d'écrits sur cette question.
Est-ce Verlaine qui enleva Rimbaud, ou Rimbaud qui enleva Verlaine, le Verlaine aux nerfs de femme ? J'ai mon idée là-dessus, mais passons. Ils restèrent ensemble, à Londres, près d'une année. Verlaine se lassa le premier, s'enfuit vers Bruxelles où Rimbaud, rappelé par lui, le rejoignit. Il y a là des faits et une psychologie également obscurs, d'autant qu'à cette intimité se joint, dans les quelques lettres de Verlaine datées de cette période, un souvenir constant de sa femme qu'il voudrait reconquérir. Enfin, à une demande d'argent de Rimbaud, Verlaine répondit par le revolver. Cela tranchait une situation sans l'expliquer. Verlaine a-t-il été victime de la vanité affreuse de Rimbaud, qui paradait alors de tous ses vices ? Peut-être, mais Verlaine cachait sous sa légère naïveté d'enfant une nature compliquée, triple et quadruple, si bien qu'on s'y perd. Il fit deux ans de prison à Mons. On a proposé récemment de poser sur la geôle une plaque commémorative. Je crois que le silence vaudrait mieux encore, si le silence était possible. Pourtant on ne peut oublier que c'est là qu'il écrivit le livre qui fait de lui un des plus grands poètes catholiques de la France, Sagesse. Les Romances sans paroles avaient paru, dans le temps même de sa prison, par les soins de M. Edmond Lepelletier ; c'est là que se trouve la fameuse ariette, tant aimée, tant répétée :
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Sa conversion, qui avait été très sincère et qui devait transparaître jusqu'en ces derniers beaux livres, Amour, Bonheur, si elle modifia quelquefois la nature de son inspiration poétique, n'eut aucune influence sur sa vie et ses mœurs. De là on a conclu qu'elle était surtout littéraire. Je ne le crois pas. Verlaine était peu capable de dissocier la raison du sentiment, mais il fut toujours l'esclave de la sensation et ne sut jamais résister à un désir physique. Ses ivresses, ses colères, ses amours furent également terribles. Soumis à ses sens, c'était un homme affreux ; dès qu'il échappait à leur tyrannie, il redevenait le poète pur et doux, le causeur à l'ironie fine, le bon camarade, le promeneur du rêve et du sourire. Malheureusement, à mesure que les jours passaient, il perdait le peu d'empire qu'il avait sur lui-même, et ses dernières années s'écoulèrent en une sorte de noce populacière où l'encouragèrent, pour son malheur et leur honte, des jeunes gens, aujourd'hui bien assagis, et dont la seule gloire aura été d'avoir bu avec Verlaine. Du moins, lui qui y semblait voué, eut-il le bonheur d'échapper à l'hôpital des derniers jours, et de mourir en un petit logis d'ouvrier rangé, soigné par sa dernière maîtresse, à qui pour cela il a été beaucoup pardonné.
Verlaine est un grand poète et il a eu une grande influence sur la poésie française. On peut dire que, quelle que soit la forme matérielle qu'elle ait affectée, vers libre, vers libéré, vers romantique, elle a été tout entière et est encore sous la dépendance de Verlaine. Les poètes les plus récemment célèbres, comme Mme de Noailles, sont verlainiens encore par une certaine manière de briser le rythme en lui conservant sa fluidité, de fuir l'apparat de l'éloquence, de négliger volontairement la rime. Ce n'est qu'assez tardivement, dans Jadis et Naguère (1885) et en termes à la fois pittoresques et un peu sibyllins, qu'il adressait à M. Charles Morice, destiné entre tous à bien pénétrer son génie, cet Art poétique où des générations de poètes ont trouvé leur appui : De la musique avant toute chose. - Ne sois point trop précis, crains la trop grande clarté. - Pas la couleur, la nuance. - Crains la pointe, l'esprit, le rire. - Pas d'éloquence, étrangle-la. - La rime ? C'est un bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime.
Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin,
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.
Malgré certaines licences, ainsi que disait encore Théodore de Banville, c'est par la langue même, bien plus que par la prosodie, que Verlaine innove. Sa phrase monte et descend de ton, tout à coup bifurque, s'oublie comme dans une suspension de la pensée distraite, repart, arrive enfin au but que son caprice ne perd pas de vue. Jamais le vers de Verlaine ne sent l'effort, la rature, le recommencement. Le petit poème, souvent un sonnet, se déroule avec une parfaite certitude, selon une franche unité de rythme, selon une musique qui chante intérieurement en lui. La poésie de Verlaine, forme et pensée, est toute spontanée ; c'est fondu à la cire perdue ; elle est ou n'est pas. Rien n'y indique la retouche. La manière ne change pas, que l'inspiration soit religieuse ou libertine, c'est la même fluidité pure, que le ruisseau roule sur des herbes ou sur du gravier, et sa voix dit toujours la même chanson amoureuse, que son amour rie aux femmes ou aux anges, et c'est presque la même sensualité. Lui-même a fondu en un recueil, Parallèlement, ces deux nuances de son rêve, érotisme et mysticisme.
De bonne foi, Verlaine, rénovateur du sentiment poétique, créateur de son verbe et de son vers, se crut le type du poète décadent. Il a exprimé cela magnifiquement :
Je suis l'empire à la fin de la décadence...
L'idée et le mot venaient de Huysmans, qui dessina, en des Esseintes, fantoche fameux, le type même de l'amateur de toutes les décadences. Cela eut des suites. Une bonne partie de la jeunesse se voulut décadente. C'est un chapitre amusant de l'histoire littéraire de notre temps, mais il y faut des détails que l'on dira une autre fois, maintenant que sont achevés les portraits de maîtres qui doivent se dresser en frontispice à ces souvenirs, comme des patrons et des protecteurs.
[entoilage : Michel Dorenlor, janvier 2001]
15. « Verlaine en pierre », Épilogues, volume complémentaire, Mercure de France, 1913
Verlaine en pierre. — C'est très bien que, métamorphosé en pierre, Verlaine se dresse sur une pelouse du Luxembourg, au faîte d'une stèle historiée, d'où il peut contempler d'un regard ironique le panorama des morales. Ah ! Celui-là, au moins, n'eut de préjugés d'aucune sorte et ceux qui, sur le conseil muet de l'effigie, voudront lire ses œuvres complètes, s'ils y trouvent quelques fadeurs, y trouveront aussi quelques piments. Car ce poète, en ses moments divins ou médiocres ou bas, ne sut jamais très bien ce qu'il faisait. Il se passa aisément de nos vaines distinctions du bien et du mal, du bon et du mauvais. Il était né avant la répartition des sensations en catégories, celles dont on se glorifie et celles dont on rougit : en lui, elles donnent l'exemple de la promiscuité primordiale. Les anciens, familiers avec les stupres divins, l'auraient mieux compris que nous, dont la domestication chrétienne a oblitéré l'entendement, et peut-être auraient-ils tout bonnement loué l'heureuse vertu de ses organes et la variété de leurs aptitudes. Pourquoi vouloir isoler de l'autre le poète sentimental ? La sentimentalité de Verlaine a pour piédestal l'homme sensuel. Il faut les contempler ensemble, — parallèlement. Verlaine est un exemple de sincérité humaine dont on ne peut mépriser un ordre d'aveux sans diminuer la franchise des autres. Il était ainsi, et ce n'est qu'ainsi qu'il est le miracle Verlaine.
A consulter :
La Journée Paul Verlaine
|